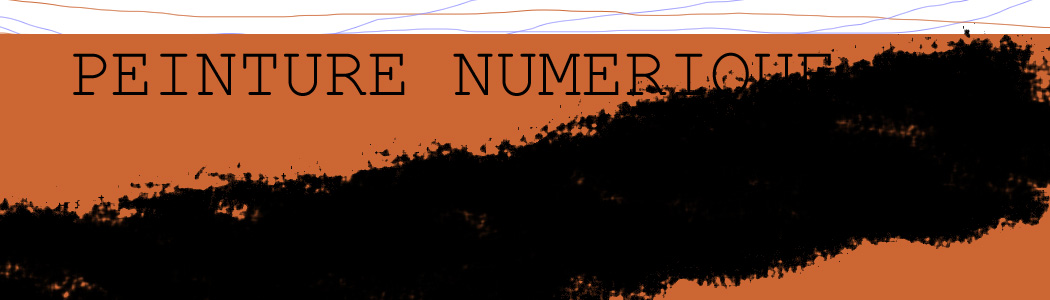Les historiens s’accordent pour expliquer l’éclosion du pleinairisme, notamment celui des macchiaioli italiens et des impressionnistes français, par la généralisation de la diffusion des couleurs en tubes. L’atelier se faisait soudainement transportable : le peintre pouvait désormais planter son chevalet et sa toile devant un paysage, sur le motif, pour réaliser une œuvre définitive et non plus un croquis à reprendre à l’atelier. Le XXe siècle a vu un retour des artistes dans leur atelier, conséquence de l’abandon des références à la natura naturata au profit de la natura naturans[1] et de l’abstraction.
L’émergence des tablettes numériques, et plus particulièrement de l’iPad, donne aux artistes l’opportunité de ressortir de leurs ateliers pour retourner sur le terrain. En un temps où les lieux d’exposition se font nomades[2], où les arts nomades[3] suscitent l’engouement, les moyens sont enfin donnés aux artistes de produire des œuvres en dehors de leur atelier. La tablette se substitue au carnet de croquis que l’artiste archétypal avait toujours a proximité de la main dans ses pérégrinations. Avec une différence essentielle, cependant, les œuvres produites sur une tablette numérique peuvent être des œuvres définitives et non des esquisses inabouties à reprendre dans l’enfermement de l’atelier[4].
Ceci ne veut pas dire que l’artiste revient nécessairement à la nature. Il peut, dans son nomadisme, décider de peindre des paysages urbains alors qu’il se trouve à la campagne. Ce qui rapproche cette technique de celle des pleinairistes, c’est l’instantanéité de l’expression. L’idée, même fugace, peut être immédiatement saisie et figée. Elle peut, dans le même moment, être diffusée au plus grand nombre, pour peu qu’une connexion Internet soit disponible. Le cycle idéation – production – monstration – diffusion, traditionnellement long et parfois laborieux ou fastidieux, peut être ainsi condensé en quelques minutes.
La tablette numérique apporte aussi la possibilité de conserver des étapes intermédiaires d’un travail, de revenir en arrière, sans que le remords soit destructif du travail en cours. L’artiste peut aisément tester différentes hypothèses, les conserver, revenir sur elles, tout en conservant la trace de ce qu’un graveur appellerait les épreuves successives. Chacune de ces épreuves peut, à son tour, donner naissance à de nouveaux développements, dans une approche plus rhizomatique que linéaire, miroir des processus naturels bien plus que de celui des industries humaines.
La tablette numérique pose enfin la question de l’unicité de l’œuvre d’art. L’œuvre numérique, en tant que telle, n’existe que sous la forme d’un fichier numérique, lequel peut être répliqué, diffusé et altéré sans restriction significative. Bien plus, encore, à l’ère du numérique, la notoriété d’une œuvre ne se mesure plus à son caractère unique, mais, au contraire, au fait qu’elle soit multipliée. Ceci n’est pas nouveau en soi. Par exemple, une des icônes de l’art du XXe siècle, L.H.O.O.Q., une carte postale[5] figurant la Mona Lisa[6] de Léonard de Vinci, affublée, par Marcel Duchamp[7], en 1919, de moustaches et d’une barbiche, n’est connue que par ses copies. Le Musée national d’art moderne, au Centre Pompidou, en possède un exemplaire[8] qui n’est qu’une réplique agrandie[9] de la carte postale originale, datant de 1930, une décennie après sa publication, par Francis Picabia, sous forme d’une reproduction[10], dans sa revue 391, en 1920. Salvador Dalí prétendra même avoir devancé Duchamp dans cet exercice de détournement… Quant à Duchamp, il proposera, en 1965, une version rasée de L.H.O.O.Q. D’autres exemples, plus récents, confirment cette tendance de fond. Les effigies normalisées d’Ernesto Che Guevara[11] ou de Mao Zedong[12] qui fleurirent dans les années 1960 et 1970 font oublier les modèles initiaux, les originaux, et relèguent leurs auteurs dans l’oubli.
Les informaticiens savent bien, d’ailleurs, que pour assurer la pérennité d’un fichier numérique – ce à quoi se réduit, in fine, une œuvre numérique –, il importe d’en faire le plus grand nombre de copies et de les stocker à des endroits différents. La multiplication des copies devient donc une condition nécessaire à la survie d’une œuvre numérique, donc à sa reconnaissance et, par conséquent, contribue à sa valorisation esthétique[13]. On se situe donc aux antipodes de la hiérarchie traditionnelle qui dévalorise les multiples par rapport aux originaux. L’unicité et la notion d’original perdent leur sens.
Dans une exposition récente[14], Gilles Guias, a grandement contribué à démontrer l’inanité de ces notions à l’époque du numérique. L’exposition présentait, côte à côte :
- un ouvrage de Jacques de Coulon[15], comprenant 365 pensées ou aphorismes,
- dont les textes sont abondamment enrichis d’illustrations[16] – imprimées, donc – de Gilles Guias ;
- les dessins originaux numériques, affichées sur un iPad qui a servi à leur conception[17] ;
- des impressions, sur un papier de qualité, de certaines des images numériques ;
- des ré-interprétations, au lavis et à l’aquarelle, de quelques-unes des illustrations du livre.
Cinq niveaux de lecture, d’étapes successives, dans un processus impliquant deux créateurs. Un observateur ignorant du processus de conception de cet ensemble qualifierait probablement d’originales les ré-interprétations alors qu’elles ne sont que le dernier maillon de la chaîne créatrice et viennent donc après. L’unicité n’est donc plus la garantie de l’originalité[18]. La multiplicité – ou la multiplicabilité – devient synonyme d’original et la production manuelle est plagiat[19]… Un paradoxe qui remet au goût du jour la notion de plagiat par anticipation chère aux Oulipiens. Où donc situer, dans cette nouvelle géographie des valeurs, la notion d’édition de luxe, avec ses tirages de tête enrichis d’œuvres originales de l’illustrateur ?
Tout ceci pousse donc à réviser la notion de valeur des productions plastiques. Un parallèle avec les productions littéraires s’impose. Les Fleurs du mal de Baudelaire ont-elles moins de valeur que les œuvres d’un obscur rimailleur besogneux parce qu’elles ont été imprimées en un plus grand nombre d’exemplaires ? A contrario, l’article racoleur publié dans un hebdomadaire à grand tirage a-t-il plus de valeur que la réflexion de fond éditée dans une revue à distribution confidentielle ? On le voit, l’art numérique va forcer les plasticiens à sortir, non pas seulement dehors, en plein air, comme les impressionnistes en leur temps, mais à quitter les ornières d’habitudes séculaires et les chemins battus pour inventer de nouvelles façons de montrer, diffuser, promouvoir et propager leurs œuvres…
____________________________________________________________________________
[1] Baruch Spinoza, Éthique I, scolie de la proposition XXIX.
[2] Par exemple le Centre Pompidou Mobile, La Borne gérée par l’association orléanaise Le Pays où le ciel est toujours bleu, le projet H Box sponsorisé par la maison Hermès ou d’autres initiatives de ce type…
[3] Souvent associés avec la notion d’arts premiers.
[4] Gilles Guias : « pas besoin de sortir papier, crayons, peinture, gomme et pinceaux. Une fois terminée, c’est une illustration prête à être imprimée. Le degré de précision est très impressionnant. C’est comme si à chaque instant, vous pouviez sortir de votre sac tout votre atelier. »
[5] 19,7 x 12,4 cm, apparemment conservée aujourd’hui dans une collection particulière parisienne.
[6] Point contesté par l’artiste et critique américaine Rhonda Roland Shearer qui prétend que le visage n’est pas celui peint par Vinci, mais une photographie du visage de Duchamp.
[7] Duchamp n’était pas vraiment novateur en la matière puisque, dès 1883, Eugène Bataille, alias Arthur Sapeck, avait exposé une Mona Lisa fumant la pipe.
[8] Propriété du Parti Communiste Français, auquel Louis Aragon l’a légué.
[9] 61,5 x 49,5 cm.
[10] Reproduction d’ailleurs approximative, sans la barbiche.
[11] Œuvre du photographe Alberto Korda, 1928-2001.
[12] Œuvre du peintre Zhang Zhenshi, 1914-1992.
[13] Laquelle ne se mesure pas nécessairement en espèces sonnantes et trébuchantes. Voir, supra, Art numérique et rétribution.
[14] Galerie Olivier Nouvellet, le 16 octobre 2011.
[15] L’art de l’étonnement, éditions Payot et Rivages.
[16] Gilles Guias : « Certaines pensées m’ont immédiatement apporté une image : le gâteau, la grenouille. Mais toutes les illustrations ne correspondent pas à une phrase en particulier. J’ai surtout eu envie de retranscrire à mon tour ce que ce livre m’inspirait. Je me suis d’abord laissé aller à la lecture de l’ensemble. J’ai eu besoin de m’imprégner du texte, de le porter en moi comme une sorte de méditation, pour pouvoir ensuite en exprimer librement et simplement l’essence – enfin celle qu’il m’a semblé en percevoir – à travers des images. »
[17] Gilles Guias : « Le numérique offre aujourd’hui des supports, comme l’iPad, qui permettent de dessiner et d’achever des oeuvres n’importe où et dans n’importe quelles conditions. Pour moi, c’est une façon de travailler extraordinaire. Et qui m’a semblé parfaitement en accord avec le livre de Jacques de Coulon. Avec l’état d’esprit dans lequel je me suis senti en le lisant. Les 365 citations choisies par Jacques de Coulon parlent de questions humaines, proches et accessibles. Le livre nous initie à la simplicité, à la légèreté, à la fluidité. L’outil que j’ai choisi pour les exprimer l’est aussi. […] J’ai moi-même été étonné de la magie avec laquelle les images surgissaient sur la tablette au moment même ou elle apparaissaient dans ma tête (ou presque). C’était du graphisme nomade... »
[18] Au sens étymologique de ce mot.
[19] Plagier : emprunter des éléments à (une production originale antérieure) selon le Trésor de la langue française.