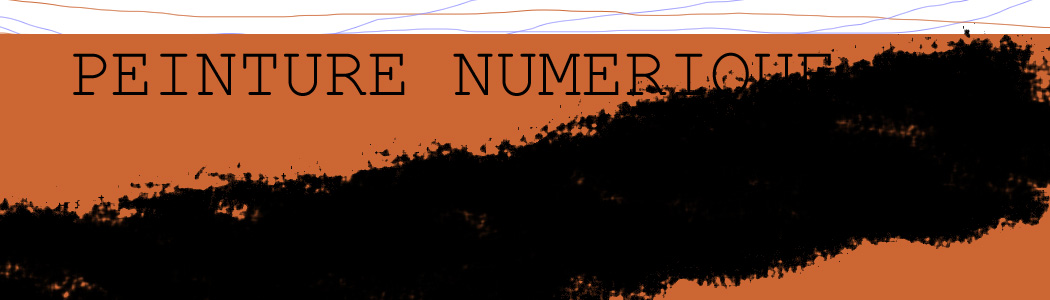En 1935, dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin développe la thèse selon laquelle l’œuvre d’art a perdu son aura du fait de sa reproductibilité facile par les moyens modernes que sont l’imprimerie ou la photographie.
Cependant, bien avant le XXe siècle, le recours à la gravure – que ce soit pour populariser des œuvres peintes préexistantes ou pour constituer de nouvelles œuvres autonomes – avait déjà largement entamé cette aura, en démystifiant l’art pour le désacraliser et le rendre accessible, non pas aux classes populaires, mais aux classes moyennes qui s’imposaient, qui apprenaient à consommer, face à une aristocratie dont les moyens financiers la rendait de moins en moins capable de consumer[1]. Il n’est pas étonnant que la gravure ait eu un essor plus rapide dans les sociétés dans lesquelles une bourgeoisie opulente s’est rapidement imposée : la Hollande, la Rhénanie, notamment.
Le débat n’est donc pas nouveau. Il n’a été qu’accentué par le perfectionnement de la technique lithographique en couleurs puis par l’apparition de la photographie, tout d’abord en tant que moyen de reproduction et de diffusion, puis comme modes d’expression artistique ayant acquis leur autonomie. Ce en quoi les techniques numériques de création nous interpellent n’est pas tant le statut de l’aura de l’œuvre, bien mise à mal par Dada, le Pop-Art, l’Art Brut, l’Arte Povera ou le minimalisme, que les notions de propriété et de rétribution de leurs créateurs.
Il y a, en effet, une différence essentielle, entre la gravure, la lithographie et la photographie classique, d’une part, et les arts numériques, de l’autre. Dans les premiers, la production de toute copie de l’artefact requiert la mise en œuvre d’un processus de matérialisation qui recourt à une matrice – le négatif photographique, la pierre lithographique, la plaque de cuivre ou de zinc – et à un subjectile – le papier ou, parfois, la toile –. Celui qui possède la matrice – disons, pour simplifier, l’artiste créateur ou ses ayants-droits – a la possibilité, moyennant l’acquisition de compétences techniques ou le recours à un technicien, de multiplier l’œuvre.
Il en contrôle ainsi la diffusion et, partant, sa valeur commerciale. Plus les tirages sont nombreux, moins chacun d’entre eux a de valeur. Plus ils sont rares, plus la valeur unitaire de chacun croît. Il peut même empêcher des tirages supplémentaires en rayant la plaque, en brisant la pierre ou en détruisant le négatif. Le créateur, dès lors qu’il jouit d’une certaine popularité, peut donc optimiser ses revenus en gérant l’équilibre entre œuvres originales et multiples, en contrôlant notamment la diffusion et le prix de ces derniers. Jean-Léon Gérôme, à la fin du XIXe siècle, est souvent donné en exemple de maîtrise du contrôle des œuvres originales et de leur produits dérivés, mais il n’est pas le premier. Les Hollandais de l’Âge d’Or l’avaient précédé en produisant des gravures en complément de leur travail de peintre. Jeff Koons et Takashi Murakami, en notre temps, ne procèdent pas autrement.
Dans l’art numérique, il existe toujours une matrice – en général un fichier numérique – mais le processus de matérialisation ne requiert aucune technicité. C’est la matrice elle-même qui est fournie. À charge du client amateur[2] de la matérialiser en recourant à un équipement banalisé[3]. Diffuser le produit fini, c’est donc aussi diffuser la possibilité, pour tout acquéreur, de le rediffuser et, par conséquent, d’en gérer la valeur commerciale et de déposséder le créateur de sa due rétribution. Les tentatives de verrouillage du processus de recopie ou de rediffusion ont été nombreuses. Les techniques les plus sophistiquées ne résistent que très peu de temps à l’ingéniosité des hackers amateurs.
Le problème est donc bien posé : le créateur d’une œuvre numérique s’en dépossède et renonce à sa rétribution, dès lors qu’il la diffuse. L’art numérique déplace définitivement le débat, dépassé, sur l’aura de l’œuvre vers celui de sa valeur commerciale et de la rétribution de l’artiste ou de ses ayants-droits.
Cette nouvelle donne appelle des solutions nouvelles pour que l’artiste puisse être rétribué pour son travail de création, ne serait-ce que pour lui donner les moyens de poursuivre son travail. Quatre grands modèles se dégagent.
- Un modèle de consumation aristocratique.
Dans ce modèle, l’artiste cède son œuvre numérique comme s’il s’agissait d’un original, à un prix qui tient compte de cette unicité. L’acquéreur est libre d’effectuer autant de copies qu’il le souhaite, sachant que, ce faisant, il contribue à diminuer la valeur commerciale de son acquisition, transformant un unicum en multiples. Ce schéma calque celui de la diffusion des œuvres uniques, négligeant la question de la reproduction, question qui risque d’ailleurs de se poser rapidement aussi pour les œuvres non numériques. En effet, avec le perfectionnement des photocopieurs, la question va inévitablement se poser de la différence entre un dessin prétendu original et sa copie, rigoureusement identique, indiscernable.
Ce modèle ne renouvelle pas la clientèle des œuvres, mais prend juste en compte le phénomène numérique. C’est d’ailleurs, peu ou prou, le schéma qui prévaut aujourd’hui pour la diffusion des vidéos d’artistes. On reste dans un cadre globalement élitiste qui préserve le statu quo des processus de la création et de la diffusion de l’œuvre. Le mécanisme de séduction, inhérent à toute démarche de vente d’une œuvre d’art, reste inchangé.
- Un modèle de consommation populaire.
À l’opposé, l’artiste cherche une diffusion de masse de sa création. L’idée est de définir un prix tel que le processus de copie illicite n’a plus de sens économique pour le fraudeur potentiel. C’est le modèle mis en avant par Apple pour la diffusion de ses applications pour iPhone ou par certaines plates-formes qui proposent des sonneries musicales personnalisées pour les téléphones portables. À quoi bon s’ingénier à pirater un objet qui ne coûte que quelques euros ? Le modèle est, ici, celui de la distribution de masse, avec pour objectif de séduire le plus grand nombre.
Ce schéma, pour qu’il ait un sens économique, impose d’élargir la base des clients potentiels. Il a, nécessairement, un impact sur la nature des œuvres offertes. On ne séduit pas la masse avec les mêmes armes que le cercle restreint des amateurs initiés.
- Un modèle de gratuité.
À l’instar des sites Internet qui offrent des services gratuits mais se financent en proposant des bannières vers des services payants tiers, l’artiste numérique peut opter pour la gratuité des oeuvres qu’il diffuse en se rétribuant, de façon indirecte, par le biais de revenus associés. Ceux-ci peuvent être endogènes ou exogènes.
Dans le premier cas, l’artiste incitera son client à investir dans une de ses œuvres non numériques, conventionnelles. La technique sera, ici, celle du teasing : susciter le désir et le passage à l’acte.
Dans le second cas, les revenus proviendront de services indépendants de l’œuvre : souscription à des revues d’art, achat d’accessoires ou de services en dehors de la sphère artistique. Dans sa forme la plus basique, il s’agira de la constitution d’un fichier d’adresses qualifiées vendable à des tiers. On est, ici, dans la sphère classique du marketing Internet.
- Un modèle d’abonnement.
Sur le modèle des éditeurs de progiciels micro-informatiques, qui ont renoncé à lutter contre le piratage mais continuent à préserver leurs revenus par une politique de versions successives de leurs produits, on peut imaginer, dans ce modèle, que la vente d’une œuvre numérique donne à son détenteur, identifié de façon unique par son adresse, la possibilité de faire évoluer son acquisition, de lui donner, en quelque sorte, une troisième dimension, temporelle. La clé du succès est, dans ce modèle, la capacité de maintenir l’intérêt du client sur une longue durée, d’entretenir son désir.
On le voit, les enjeux sont d’importance et obligent l’artiste numérique à travailler dans une autre dimension, à agir pour entretenir le désir de ses acquéreurs bien au-delà de la phase de séduction initiale. L’œuvre numérique, même statique, doit intégrer les facteurs d’usure, d’accoutumance, d’habitude et de la lassitude, pour continuer à séduire. En sus de sa dimension créatrice, de la volonté d’expérimenter, de découvrir des terrae incognitae, l’artiste numérique doit aussi faire œuvre de marketing, mais un marketing renouvelé à chaque nouvelle œuvre. Marketing qui peut aller jusqu’à se fondre avec l’essence même de l’œuvre numérique.
 Dessin numérique téléchargé sur epaper
Dessin numérique téléchargé sur epaper
En art numérique, tout est encore possible. Tout est à inventer ou à réinventer, dans un univers où le ludique a aussi son rôle à jouer, ouvrant sur des mondes inexplorés. Et, dans ces mondes nouveaux, jamais les processus de création et de monstration ou de diffusion de l’œuvre n’auront été aussi imbriqués, indissociables.
[1] En référence à l’ouvrage de Georges Bataille, La part maudite, essai d’économie générale, 1949, qui met en lumière la notion de destruction et de perte de la consumation aristocratique, en opposition à la rationalisation des dépenses de la consommation bourgeoise.
[2] On pourrait imaginer que le créateur contrôle lui-même la matérialisation de son œuvre, en fournissant, par exemple, des tirages sur papier. Il ne s’agirait plus, en l’occurrence, d’art numérique, mais simplement, à l’instar de la photographie, du recours à des techniques numériques pour produire des œuvres d’art conventionnelles.
[3] N’oublions pas que le e-paper en couleurs et les imprimantes 3D, capables de produire des objets en volume, sont déjà ou seront très prochainement disponibles. L’inévitable réduction des coûts de ces équipements va les rendre rapidement accessibles au plus grand nombre.